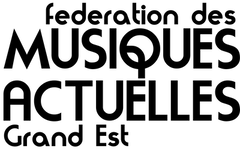communiqué
Le paysage de l’enseignement supérieur culture (ESC) est constitué d’une centaine d’établissements d’enseignement supérieur couvrant cinq domaines (architecture et paysage, patrimoine, arts visuels et design, spectacle vivant, audiovisuel et cinéma), employant 4500 agents et accueillant plus de 36 000 étudiants dont un tiers sont diplômés chaque année. Les diplômes de l’ESC donnent accès aux carrières d’architecte et de conservateur du patrimoine, de plasticien et designer, de comédien, de metteur en scène, de danseur, chorégraphe, instrumentiste, chefs d’orchestre, marionnettiste, circassiens et réalisateur de cinéma et de l’audiovisuel, ainsi qu’à d’autres métiers relatifs à ces domaines.
L’insertion professionnelle des jeunes diplômés est une notion à manier avec prudence dans le champ des métiers artistiques, où le caractère vocationnel, la précocité des pratiques et la rencontre des œuvres jouent un rôle majeur en début de trajectoire. Elle s’est imposée depuis les années 2000 comme une priorité des écoles d’ESC, conséquence de leur inscription dans le système licence-master-doctorat (LMD). C’est pourquoi elle est portée par le ministère de la culture à travers des dispositifs nationaux et mesurée annuellement au moyen d’une enquête de son département des études, de la prospective, de la statistique et de la documentation (DEPS).
Les établissements d’ESC ont développé, avec le soutien du ministère, une grande diversité de dispositifs et d’actions pour professionnaliser leurs étudiants et accompagner leurs diplômés vers l’activité. On y distinguera les dispositifs de professionnalisation des étudiants s’inscrivant dans les cursus des actions d’immersion et de référencement des diplômés au sein des communautés professionnelles. Malgré la richesse d’offres d’action en faveur de l’insertion professionnelle, seul une minorité de jeunes diplômés en bénéficient pendant ou après leur cursus : 13% de bénéficiaires au total, soit 2% pendant la formation et 11% après obtention du diplôme. Il reste donc une marche à franchir pour que ces dispositifs touchent dans l’avenir une majorité d’étudiants de l’ESC.
Le rapport de l’IGAC dresse un inventaire de ces dispositifs d’insertion et en établit une typologie. Il explore en outre les outils de mesure de l’insertion professionnelle, qu’ils soient spécifiques à l’ESC ou englobent l’ensemble de l’enseignement supérieur. Il préconise plusieurs mesures pour affirmer la priorité de l’insertion professionnelle dans le cadre normatif et conventionnel de l’ESC et renforcer son pilotage stratégique au niveaux central et déconcentré. La création prochaine au ministère d’une nouvelle direction générale de la démocratie culturelle, de l’enseignement et de la recherche (DGDCER) ouvre, selon les auteurs du rapport, l’opportunité d’ériger l’insertion professionnelle en troisième pilier de l’ESC, à côté de l’enseignement et de la recherche. Elle devrait permettre de développer des outils, notamment numériques, pour mesurer la portée des dispositifs d’insertion et leur donner une visibilité accrue .
 En cours de chargement…
En cours de chargement…